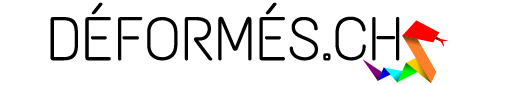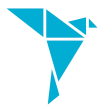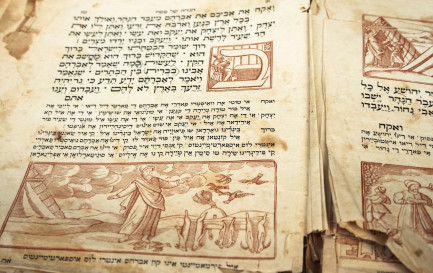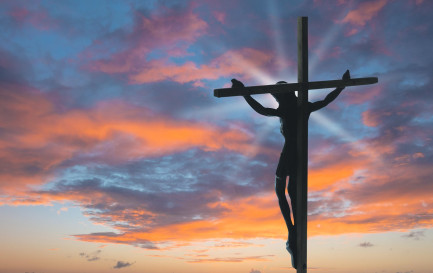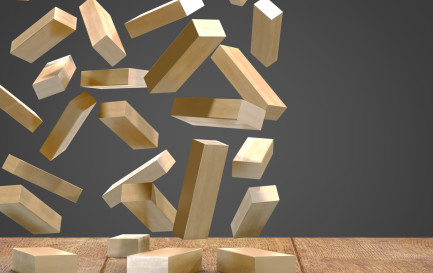Une fascination pour la force
Sous le masque de la force: la faiblesse
Dans un ouvrage collectif inclassable, une vingtaine de penseurs croisent leurs regards dans une perspective de «décloisonnement» des savoirs – histoire, sociologie, anthropologie, littérature, droit. Récits, essais, écrits épistolaires… tentent de cerner cette notion qui «relève d’une relation, de la comparaison avant parfois de référer à un rapport social. Il n’y a de faiblesse que parce qu’il y a de la puissance». Reste que «la faiblesse n’est pas toujours où on le pense. […] L’avidité est une faiblesse, le goût de la domination participe de la fragilité humaine. Celui qui viole le territoire souverain de l’autre est lui aussi le jouet d’une force dont il ne parvient pas à se libérer».
Une situation de faiblesse offre aussi un poste d’observation privilégié de la puissance et de la domination, la faiblesse est donc aussi un «lieu stratégique éphémère». Par rapport à la pauvreté ou à la vulnérabilité, la faiblesse permet de réfléchir à ce qui fait l’humain. Et se comprend surtout comme «une impuissance» qui invite, dans le même mouvement, à réfléchir à toutes celles et tous ceux qui font le choix volontaire de renoncer à leur propre puissance d’agir. N’est-ce pas là aussi ce qui fait de nous des humains? C. A.
Figures de la faiblesse, sous la direction de Thomas Hunkeler et Marc-Henry Soulet, «Sociologie et littérature», Epistémé, Lausanne, 2024, 200 p.