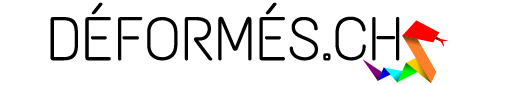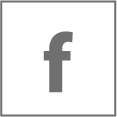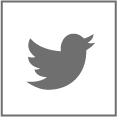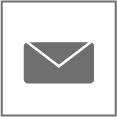«Si l’on méprise les pauvres, ont trahit l’Evangile»
Son appel à la miséricorde a été relayé par de nombreux médias. Lors de la célébration religieuse donnée dans le cadre de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, en janvier dernier, Mariann Edgar Budde, évêque épiscopalienne de Washington, a rappelé que «la grande majorité des immigrants ne sont pas des criminels». Un discours qui n’avait pas plu au président des Etats-Unis, qui avait exigé des excuses le lendemain. Une anecdote qui illustre les tensions qui existent un peu partout entre des Eglises qui par leurs aumôneries et leurs œuvres s’engagent en faveur des migrants et des minorités et des mouvements politiques nationalistes et conservateurs qui déclarent défendre les valeurs chrétiennes.
Évangile scandaleux
«Cette évêque, sans élever la voix, sans agir comme Trump, rappelle des éléments du Sermon sur la montagne: le respect de l’autre, du plus fragile», rappelle le pasteur et ancien élu biennois Cédric Némitz. «Elle a juste prêché l’Evangile et cela a provoqué un scandale. Si l’on défend l’idée de la loi du plus fort, si l’on méprise les pauvres, on trahit l’Evangile!» défend-il.
Dès lors, ne devrait-on pas entendre davantage de voix religieuses sur ces questions? «Quand les Eglises prennent la parole sur ces champs-là, elles ne sont souvent pas bien entendues. Des voix politiques ou économiques leur font savoir que ce n’est pas leur rôle», constate le pasteur Pierre-Philippe Blaser, membre du Conseil de l’Eglise évangélique réformée de Suisse. «En réalité, 99% du temps, les Eglises ne font pas de politique mais de l’accompagnement spirituel, des célébrations, de l’écoute, de l’entraide. Bien que leurs prises de parole engagées se fondent sur des connaissances et des valeurs, certaines personnes le perçoivent mal, et cela tend à diviser les croyant·es», observe le ministre, pour qui agir sur le terrain est déjà une prise de position.
S’il souhaite que la diversité des opinions ait sa place dans une vie communautaire, Pierre-Philippe Blaser s’inquiète de la dégradation des conditions de débat. «Le protestantisme est attaché à l’idée que la vérité ne s’acquiert pas dans le ressassement mais dans la délibération. Une manière de voir à l’opposé de l’indifférence aux faits qui autorise qu’un mensonge mille fois répété devienne une vérité.» La bonne foi des arguments serait-elle en train de céder sa place dans un monde où compte avant tout de se faire entendre? «Les personnes qui ont une lecture consciencieuse de l’actualité ne sont pas celles qui crient le plus fort. On est en train de perdre le sens du débat contradictoire au profit de la vocifération en boucle.»
Le théologien pointe aussi un glissement: une vie accomplie se mesure moins en qualité qu’en chiffres. «D’aucuns pensent hâtivement que leur réussite en affaires ou la multiplication de ‹likes› sur leur site internet constituent les meilleurs signes de l’approbation de Dieu» prévient Pierre-Philippe Blaser. Cédric Némitz abonde: «On simplifie, on réduit les choses. Et du coup, on manipule la vérité pour obtenir des arguments qui font ‹tilt› dans la tête des gens», prévient-il.
Perte de valeurs
En bon Biennois, il fait référence au chanteur Nemo, gagnant du concours Eurovision de la chanson. «Cette société a cassé les codes. On a cassé les codes nationaux, de l’identité de genre, de la tradition, des frontières… On a cassé les codes de plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus. Il faut prendre ça très au sérieux. Si j’avais continué de faire de la politique, je ferais un discours populiste. Il faut que ces gens qui sont dans le trouble puissent s’accrocher à autre chose qu’à la simplification manipulatoire», s’inquiète Cédric Némitz.
Le plus du web
La Bible interroge la légitimité des pouvoirs. Trois questions à Thomas Römer, professeur de milieux bibliques au Collège de France.