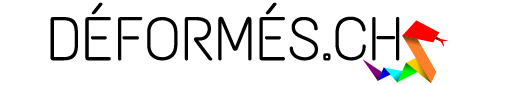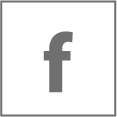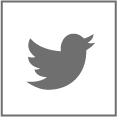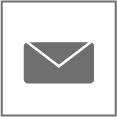«Et si le religieux était fondamentalement une expérience sensorielle?»
Comment définir les danses néo-spirituelles?
Cet ensemble de pratiques consiste plutôt en des mouvements dansés qui se veulent spontanés, libres, non chorégraphiés, sur un fond musical. L’espace de danse est souvent considéré comme sacré par les danseurs. Il peut se trouver en pleine nature, dans une salle parfois louée pour l’occasion, comme cela a été le cas pour l’église réformée Saint-Jacques de Lausanne. Ces pratiques sont majoritairement féminines.
D’où viennent-elles?
Toutes ces danses sont nées dans les années 1970-80 dans la contre-culture américaine, en particulier à New York. La danse des 5 Rythmes, créée par Gabrielle Roth (1941-2012) pour se remettre d’une blessure, opère comme une matrice. Aujourd’hui s’y est ajoutée une dimension spirituelle: on y intègre des autels païens, des pratiques éco-spirituelles… Une trentaine de types de ces danses extatiques se retrouvent en Suisse sous diverses appellations: mouvement medicine, dansualité, danse du cacao, open floor… Ces approches alternatives du corps vont souvent de pair avec une critique sociale de l’idéologie de performance.
Pour vous, ces danses interrogent notre compréhension du religieux…
La science des religions est marquée par des théologiens protestants qui ont construit l’épistémologie de cette discipline à partir de textes, de mythes, de symboles. En ce sens, le religieux et ses intermédiations sont avant tout des activités cognitives et mentales. Or, sous l’influence des mouvements féministes, décoloniaux et de l’essor d’expressions religieuses minoritaires (tatouages, pratiques alimentaires…), un nouvel intérêt pour le corps s’est fait jour. Dans la recherche, on qualifie ce mouvement de body boom.
De plus en plus de recherches s’intéressent à la matérialité du religieux, à sa sensorialité. Celle-ci a toujours existé, mais désormais les chercheurs font aussi appel à leurs propres sens pour saisir un phénomène religieux. Un autre rapport au religieux se fait ainsi voir, dans lequel le corps est le siège d’états permettant le travail sur soi, la connexion aux autres, à plus grand, etc. Ce qui incite à se demander: «Et si le religieux n’est pas, au fond, une affaire corporelle?»
Ces nouvelles danses sont-elles vécues comme une capacité d’agir sur soi-même?
Cette grammaire des nouvelles spiritualités autour du self est très nourrie par les philosophies romantiques, la spiritualisation de l’expérience humaine. L’autorité intérieure, le non-conformisme, l’authenticité sont valorisés: dans ces milieux on parle de trouver « sa » danse, d’être guidé par « ses » propres pas, de retrouver « sa » voix intérieure qui serait source de spiritualité, une intuition réveillée par le mouvement et à laquelle on aurait «perdu accès». En cela, ces danses sont très politiques. Elles sont aussi associées à des processus plus vastes de transformation de soi.
La recherche
«When I dance, I feel the Earth under my feet: Aesthetics and Material Culture in Swiss Neo-Spiritual Dances», Manéli Farahmand, Material Religion, 2024, 22 p.
En savoir plus:
Ritual Embodiment est un projet FNS dirigé par Oliver Krüger, professeur d’études religieuses à l’Université de Fribourg, www.ritual-embodiment.ch.